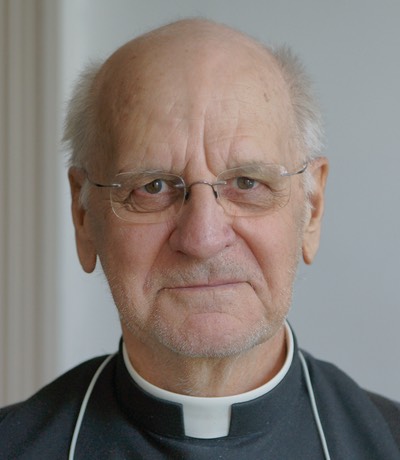Darras tome 32 p. 457
40. N'espérant plus avoir un fils pour héritier, bien qu'il eût épousé dans sa vieillesse Germaine de Foix. une parente du roi de France, l'Aragonais avait eu la pensée de partager ses couronnes entre ses deux petits-fils, s'il ne pouvait entièrement déshériter Charles. Il ressentait pour ce dernier, qui n'avait jamais quitté sa principauté des Flandres, une aversion dont les vieux monarques ne se défendent pas toujours à l'égard de leurs successeurs. La jalousie de la domination semblait augmenter dans son âme, à mesure qu'il approchait du terme de sa vie. A ses yeux, Charles était en quelque sorte un étranger, un teuton, peu digne de régner sur l'Espagne. Dans son testament, il avait, par une singulière anoma-
-------------
1Pont. Hicteb. Reb. Austriac. vu, 2. ' PiUL. Jov. Vita Adriani, pag. 9t.
==========================================
p458 PONTIFICAT DE LÉON X (1513-1521).
lie, institué le plus jeune des deux frères régent de Gastille et d'Aragon jusqu'à l'arrivée de l'aîné, n'osant franchir cette limite ; mais il lui léguait absolument la dignité de grand-maître des trois Ordres militaires espagnols, ce qui constituait une puissance à peu près indépendante, une personnelle royauté dans la royauté na-tionale. Au dernier moment, toutefois, cédant au remords de sa conscience, éclairé par les courageuses représentations de ses meilleurs amis, il avait supprimé ces deux clauses, qui ne pouvaient manquer d'ouvrir une interminable série de dissensions domestiques et de guerres intestines. Il avait nommé le cardinal Ximénès, qu'il estimait sans l'aimer, régent de la Castille, et son propre fils naturel, l'archevêque de Saragosse, régent de l'Aragon. Celui-ci n'était guère là que pour la forme. Sur le cardinal, qui touchait à ses quatre vingts ans, allait peser le fardeau de la régence. Il l'accepta cependant avec autant d'abnégation que de simplicité, comme un devoir patriotique: ou même sacerdotal. N'ayant plus rien à faire pour la gloire, ce dont il ne se doutait certes pas, tant l'immolation lui semblait naturelle, il voulait jusqu'au bout travailler pour le bien. Une longue expérience ne lui permettait d'ignorer ni les obstacles à vaincre ni les fatigues à supporter dans cette position éminente. Rien n'avait faibli dans le généreux et saint vieillard. Au soin des affaires publiques, on le vit ajouter comme dans ses meilleures années le culte de la science, les pratiques d'une fervente piété, les exercices habituels de la vie religieuse1. Il venait de prendre en main les rênes de l'état avec son application ordinaire, quand Adrien d'Utrecht, le nouvel évêque de Tortose, se présenta pour remplir la même mission, porteur des pleins pouvoirs délivrés à Bruxelles par le jeune souverain.
41. La compétition n'était pas sérieuse dans la pensée des Espagnols, pas plus que la comparaison n'était possible entre les deux régents. Le bon sens politique et la fierté Castillane auraient bientôt résolu la question, si Ximénes lui-même n'avait plaidé la cause de son compétiteur : il lui laissa les honneurs du titre, en gardant
--------------------
1. Gomés. Reb. Gesi. Ximen. pag. 130.
=========================================
p459 CHAP. VII.— l'orient et l'espagne.
la responsabilité de l'honneur. Adrien savait combien ses compatriotes, restés à la suite de Philippe le Bel, étaient impopulaires et détestés dans la Caslille : il évita toute collision en se résignant au partage. Le vrai régent avait d'ailleurs assez de difficultés sur les bras. La première lui fut suscitée par le prince dont il gérait les intérêts et préparait l'avenir. Cet avenir, Charles risquait de le compromettre en s'y précipitant. Il n'avait pas plutôt appris le décès de son grand-père que, guidé par ses conseillers flamands, il avait placé la couronne sur sa tête et s'était proclamé roi. Selon les lois espagnoles, qui ne comportaient aucune exception, les trônes vacants appartenaient de droit à sa mère Jeanne. Que les infirmités de cette reine légitime ne lui permissent pas d'exercer la souveraineté, de gouverner personnellement ses royaumes, ce que nul acte public n'avait déclaré, la présomption légale était pour elle, tout changement dans l'ordre de la dynastie devait avoir l'adhésion préalable des grands. En y portant atteinte, non-seulement Charles avait méconnu le respect qu'un fils doit à sa mère, mais il avait de plus enfreint la Constitution et blessé le premier corps de l'état. Ces récriminations étaient autant de menaces1. Quoique Ximénès eût énergiquement blâmé la dangereuse précipitation où venait de tomber la cour de Bruxelles, il n'en résolut pas moins de maintenir les droits du légitime héritier. N'ayant cessé de rester en communication avec le Pape, pendant tout le concile de Latran et dans toutes les graves questions qui touchaient aux intérêts de l'Eglise, il savait les intentions de Léon X à cet égard ; celles de l'empereur n'étaient pas moins certaines. Le régent commença donc par s'assurer du jeune Ferdinand, qui pouvait aisément devenir le centre de la résistance et le drapeau de la coalition. Sous prétexte de mieux veiller à sa sûreté, il lui donna Madrid pour résidence et l'eut constamment auprès de lui. Cette précaution n'arrêtant ni les murmures ni les menées hostiles, il assembla tout à coup les nobles qui se trouvaient alors dans la nouvelle capitale. La réquisition du roi leur fut immédiatement présentée ; mais, au lieu de
-------
1Miniana, Continuât. Mari, ia principio.
==========================================
p460 PONTIFICAT DE LÉON X (1513-1521).
l'admettre avec soumission, ils revendiquèrent à haute voix le maintien de leurs privilèges, en même temps que celui des droits de la reine et de la nation. « Vous errez, Messires, interrompit le cardinal d'un ton imposant et ferme ; vous êtes réunis, non pour délibérer sur une chose douteuse, mais pour obéir à des ordres formels : votre roi vous somme de le reconnaître, et ne vous demande pas de le conseiller. Aujourd'hui même il sera proclamé dans Madrid, bientôt dans toutes les villes du royaume1. » C'est ce qui ne manqua pas d'arriver.
42. En Aragon, l'archevêque de Saragosse fut moins habile ou moins heureux que le primat de Tolède en Castille. Charles n'y fut reconnu roi qu'à son arrivée dans la Péninsule. Non content d'affermir la couronne sur la tête de ce prince, Ximénès voulut en relever l'éclat pour en agrandir la puissance. Il fallait dans ce but amoindrir les privilèges exagérés des nobles, ainsi que leurs immenses possessions ; il fallait surtout transférer à la royauté le pouvoir militaire que le système féodal mettait entièrement dans leurs mains. C'était une périlleuse tentative. Il n'hésita pas. Sa munificence plus que royale, rehaussée par l'inaltérable austérité de ses mœurs et son abnégation personnelle, la justice de son administration, son amour pour les pauvres et sa réputation de sainteté le rendaient l'idole du peuple. Les grands eux-mêmes subissaient son ascendant, comme nous venons d'en avoir la preuve. Sa rigoureuse et sage économie dans le maniement des deniers publics lui permit de lever directement des troupes, d'enrôler les bourgeois et les paysans, sans recourir à l'intermédiaire des barons ; ce qui mettait le peuple en rapport immédiat avec la royauté. Cette milice nationale, à la solde du souverain, avait pour raison d'être, dans le programme gouvernemental, la nécessité de repousser les dangereuses incursions des Maures d'Afrique ; mais les seigneurs espagnols ne s'y trompaient pas : ils excitèrent des mouvements séditieux dans plusieurs villes importantes, telles que Burgos et Valladolid. Par sa rare prudence, aussi bien que par son invincible énergie, le car-
------------------
1Gomes. Reb. Gest. Ximen. pag. 160.
========================================
p461 CHAP. VII. ORIENT ET L ESPAGNE.
dinal vint à bout de ces révoltes partielles. Dans les succès obtenus il puisait une force toujours croissante pour la réalisation de sa grande pensée : ne pouvant remonter à l'origine de toutes les usurpations, il supprima du moins les rentes que le monarque défunt payait à certains nobles, les déclarant éteintes par sa mort. Un plus grand nombre encore furent contraints de restituer les domaines royaux dont ils s'étaient emparés sous le dernier règne. Ximénès trouvait ainsi le moyen d'acquitter pleinement les dettes réelles que Ferdinand avait laissées, d'envoyer des sommes considérables à son successeur 1 de créer d'abondantes réserves et d'établir des arsenaux tels que n'en possédait aucune puissance européenne.
43. La nation applaudissait; les seigneurs alarmés formaient des cabales, ils ne voulurent pas cependant en venir aux dernières extrémités sans avoir présenté leurs requêtes et demandé de loyales explications au régent. L'amiral de Castille, le duc de l'Infantado et quelques autres furent chargés de cette délicale mission. Ne perdant rien de son calme, Ximénès leur répondit d'abord sans prononcer une parole, en mettant sous leurs yeux le testament de Ferdinand et la ratification de ce testament par le roi Charles. Loin de se montrer déconcertés, ils attaquèrent la validité de ces deux actes. Portée sur ce terrain la conversation devint aussitôt orageuse. On était debout, et le cardinal, soutenant toujours sa cause, menait insensiblement le groupe vers un balcon d'où l'on apercevait un puissant corps d'armée, avec un train formidable d'artillerie. «Voilà mes lettres de créance, dit-il froidement aux délégués ; c'est en vertu de ces pouvoirs que je gouverne la Castille, et la gouvernerai jusqu'à ce que le roi votre maître et le mien vienne prendre possession de son royaume. » L'argument était décisif; les mécontents comprirent, et la paix fut assurée du coté des Espagnols : tant qu'ils eurent un tel homme à leur tête, ils mirent leur fierté dans la soumission, et non plus dans la résistance. Ce fut alors le tour des Flamands ; leurs plaintes et leurs accusations affluèrent à
-------------------------
1. FkRHERA, Hist. Hisp. tom. VIII, pag. 433.
==========================================
p462 PONTIFICAT DE LÉON X (1513-1521J.
Bruxelles. Le doux et pacifique Adrien d'Utrecht ne se montrait pas, disaient-ils, au niveau de sa position ; il fallait autour de lui des ministres capables de lutter contre le génie dominateur qui l'annihilait. Ces ministres arrivèrent : ils furent également absorbés par le primat. Les préoccupations de la guerre vinrent s'ajouter aux soucis de l'administration. Jean d'Albret jugea le moment favorable pour reconquérir la Navarre espagnole, dont Ferdinand d'Aragon l'avait récemment dépouillé. Il fut cruellement déçu dans ses espérances et prévenu dans ses desseins. Battu par une armée que Ximénès avait lancée, sous les ordres d'un habile chef, à travers les gorges pyrénéennes, il rentra dans le château de ses aïeux, où la mort mit fin à ses aventures1. Le régent fut moins heureux dans cette même année sur le sol africain, théâtre qui retentissait encore du bruit de ses exploits, et redisait d'une manière éclatante son dévouement au triomphe de la religion et de la patrie. Le fameux corsaire Aroudj Barberousse, qu'on disait fils d'un grec renégat de Lesbos et d'une femme andalouse, s'était emparé d'Alger sur le Cheik arabe Salem ebn-Temi, dont il se débarrassait par le glaive, quand celui-ci l'appelait à son secours. Enivré de sa brusque et sanglante fortune, il menaçait d'extermination la colonie chrétienne d'Oran. Les troupes envoyées par Ximénès à sa rencontre, emportées par leur téméraire valeur, subirent une déplorable défaite 2, compromettant les succès naguère obtenus ; leurs débris se rejetèrent dans les murs de la place, ou même passèrent le détroit et retournèrent en Espagne.
44. Cet échec, le seul que le noble vieillard eût éprouvé dans cours de son gouvernement, n'ébranla nullement sa grande âme. La manière dont il le supporta, lui qui n'avait jamais su que vaincre, montra sa vertu sous un jour nouveau, parut augmenter sa gloire par sa résignation dans le malheur, fit de ce revers sa plus belle victoire. Il sentait néanmoins le poids des années, et par de fréquents messages il pressait le jeune roi de venir le relever de son poste et parer aux dangers qui ne manqueraient pas de surgir
-----------------------
1. D. Marte*. Epist. pag. 570.
2. Goïes. Reb. Gest. Ximen. lib. VI, pag. 179.
=========================================
p463 CHAP. Vil. — L ORIENT ET L ESPAGNE.
à sa mort. Il lui dénonçait la principale cause du malaise présent et des futurs orages : elle était dans l'insatiable cupidité des Flamands, qui ne cessaient de provoquer les murmures et l'indignation de l'Espagne entière, d'un peuple aussi jaloux de ses droits que dévoué pour ses maîtres. Le cardinal puisait, dans son absolu désintéressement, dans la fermeté de son caractère et les constants exemples de sa vie, la noble liberté de son langage. Retenu d'abord par des conseils intéressés, Charles le fut ensuite par le désir d'entrer en accommodement avec le roi de France, qui désirait lui-même conclure la paix avant d'entrer en lutte avec son jeune rival. Des conférences s'ouvrirent à Noyon par plénipotentiaires : d'un côté, le fameux seigneur de Chièvres, dont l'habileté nous est déjà connue ; de l'autre, le sire de Boisy, qui ne le cédait pas à son antagoniste. Tendant au même but, ils ne rivalisaient que d'intelligence, pour le bien des pays et l'honneur des monarques qu'ils représentaient. La paix momentanée de l'Europe devait être le résultat du traité de Noyon ; mais, comme il avait pour principale base un engagement matrimonial entre le roi d'Espagne et la fille unique de François Ier 1à peine âgée d'un an, que de tempêtes pourront se déchaîner et briseront en réalité cette faible trame ! Bien que le traité fût assez promptement conclu, les retards se prolongèrent encore. Dans le mois d'août 1517, Ximénès tombait dangereusement malade ; et cette maladie fut regardée comme l'effet d'un poison que plusieurs historiens attribuent aux ennemis jurés de l'incomparable ministre, plus spécialement aux étrangers dont il enrayait les déprédations. Au mois de septembre, Charles débarquait enfin à Villa-Viciosa dans les Asturies, au milieu des acclamations et des transports de joie d'un peuple naturellement enthousiaste, et qui depuis si longtemps soupirait après son arrivée. Il était accompagné par l'inévitable de Chièvres, sans lequel il semblait ne pouvoir agir ni penser. Une nuée de Flamands rapaces l'entourait et s'abattait avec lui sur la malheureuse Espagne.
45. Malgré ses longues infirmités et ses intolérables souffrances.
----------------
1 Miruiu, Continuai,
lib. I, cap.
3 ; — Gomes. ubi supra.
=========================================
464 PONTIFICAT DE LÉON X (1513-1521).
le vieux cardinal s'était mis en route pour aller au-devant de son roi. Il pouvait assurèment lui donner ce titre, puisqu'il en était l'auteur et que Charles lui devait sa couronne. Contraint de s'arrêter à Roa, petite ville de la province de Burgos, il lui manda par une sublime et touchante lettre combien il souhaitait la suprême consolation de le voir avant de mourir. Ce n'était pas le compte des courtisans et des sycophantes. Ils persuadèrent au roi de repousser une telle entrevue, dont ils redoutaient les effets pour eux-mêmes. Sur leur conseil, Charles se contenta d'écrire, remerciant froidement le primat et l'autorisant à rentrer dans son diocèse pour y terminer en paix, loin des bruits du monde et des agitations de la cour, sa laborieuse carrière. La missive royale passa-t-elle sous les yeux de l'archevêque mourant? Plusieurs l'affirment, d'autres paraissent en douter ; mais cette lecture n'était pas nécessaire : Ximénès avait tout compris. Un dédaigneux silence accueillait déjà ses exhortations paternelles et ses sages conseils; on affectait de prendre des mesures contraires à celles qu'il recommandait ; et puis, du moment où ce jeune homme auquel il remettait un royaume plus florissant qu'il ne l'avait jamais été, une autorité plus vaste et mieux établie que celle de ses plus illustres ancêtres, n'était pas venu se jeter dans ses bras et lui donner un témoignage de reconnaissance, le saint vieillard pouvait-il conserver une illusion ? En regard de cette ingratitude que la postérité ne pardonnera pas à Charles-Quint, en dépit de ses triomphes, nous aimons à placer les délicates et généreuses attentions de Léon X. Par une bulle directe et personnelle1, il enjoignait à ce même vieillard, en vertu de la sainte obéissance, sous peine même d'encourir son indignation, de suspendre les austérités qu'il pratiquait alors comme dans la force de l'âge, lui prescrivant de remplacer le jeûne et l'abstinence par la charité, le dispensant des mortifications et des exercices monastiques, voulant enfin, disait-il, conserver un tel homme à l'Espagne, à l'Église, au monde entier. C'était trop tard ; le 8 novembre 1715, quand il venait d'entrer dans sa quatre-vingt deuxième année, le
---------------
1 Ext. apud Gomes., Reb. Gest. Xirnen. lib. VII.
=========================================
p465 CHAP. VII. — PERTURBATION ET RELÈVEMENT, ETC.
grand homme mourait comme meurent les saints, donnant l'exemple d'une résignation héroïque, après avoir demandé lui-même les derniers sacrements, en murmurant cette parole du psalmiste : In te Domine speravi; non dans les princes, mais en Dieu seul! Sa tombe sera glorieuse, et prolongera l'action, en même temps que l'honneur de sa grande existence. Conformément à son désir, on l'inhuma dans l'église de Saint-Ildefonse, à l'université d'Alcala de Hénarès, l'ancienne Complutum, où lui fut érigé plus tard un monument splendide. Mais un monument plus digne de lui, c'est l'université même d'Alcala, fondée par ses soins, avec les revenus de son diocèse. II laissait un autre monument, supérieur à celui-là peut-être, la fameuse Polyglotte de Complutum, érigée pour l'avancement des études bibliques, réfutation anticipée des opiniâtres et stupides calomnies qui n'allaient pas tarder à s'élever contre l'Église Romaine. On attribuait à Ximénès le don des miraeles, même de son vivant. L'Espagne le pleura comme un père et l'honore toujours comme un saint, bien que sa canonisation, longtemps poursuivie par les rois et les peuples, n'ait jamais été prononcée. Charles dut bientôt déplorer la perte de ce grand homme et son propre aveuglement quand une formidable ligue mit en péril la couronne qu'il lui devait.